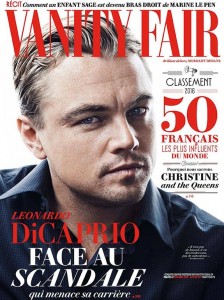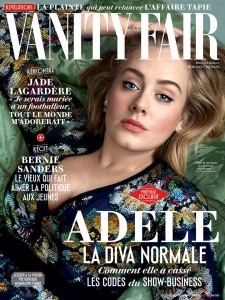Vanity Fair n° 43 – février 2017
Veuf depuis des années, c’est un Archimède désabusé que les voisins croisaient dans les rues du quartier. Depuis quelques jours son pas a changé, son regard brille d’une lueur amusée. Il est amoureux. Il ne doute pas, il ne fanfaronne pas non plus. Il avance serein et souriant en respirant l’air à pleins poumons.
Découverte puis observée discrètement dans la file d’attente de la boulangerie où il se rend quotidiennement, la jolie femme qui lui redonna du souffle s’appelle Graziella, elle a 40 ans et est divorcée.
Son premier regard fut attiré par l’ondulation chatoyante de ses cheveux parfaitement coupés dans lesquels il a vite eu envie de glisser ses doigts. Au delà de son visage attrayant et de sa belle personne, la manière souveraine de Graziella d’attendre dans la file, délicate et attentive – jamais ennuyée – l’intrigua, puis l’attira vers elle irrésistiblement. Elle aussi avait repéré ce monsieur très digne d’un certain âge ; elle imaginait un ambassadeur à la retraite. Ils se répondaient par un sourire courtois quand leurs regards se croisaient, mais cela n’allait pas plus loin.
Dans leurs esprits les projets et hypothèses de se rapprocher bouillonnaient. Les corps, eux, restaient impassibles et sinistrement raisonnables. Ne serait-ce pas plutôt l’inverse ? Le corps exprimant des besoins naturels que l’esprit s’ingénue à contrarier sans cesse.
Archimède n’a plus la force de courir après les gazelles, il déguste son engouement et retarde le plus possible l’instant où il se dirige vers Graziella pour rompre définitivement la distance. Graziella espérait qu’il l’invite à faire plus ample connaissance. Elle souhaitait mettre fin au trouble tout en ne souhaitant pas précipiter les choses, trop consciente de la saveur qui réside dans la tension du désir que génère l’attente.
L’extravagance silencieuse de certains vieux est de renoncer à toute nouvelle histoire d’amour ; Archimède distille et déguste la promesse que la providence lui tend, il doute aussi. Tout bascule le jour où apercevant Graziella prendre place dans la file loin derrière lui, il décida d’aller lui parler. Il acheta pour elle le pain de seigle coupé en tranches ‘’pas trop fines’’ comme elle a l’habitude de commander et vint la rejoindre :
− Vous n’aurez pas à attendre cette fois. Lui dit-il en lui offrant son pain.
− Oh ! et si aujourd’hui je voulais une baguette tradition, comme vous ?
− Je vous proposerai de l’échanger et chacun repartira de son côté avec la part de l’autre pour lui tenir compagnie. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ?
− Je préfère que vous deviniez…!
L’humeur se veut badine et pourtant l’heure est grave.
L’un et l’autre entretiennent un sentiment d’urgence. Ils ont besoin d’aimer, ils le savent. La solitude les écrase. Mais jouer à faire semblant et dissimuler ses envies sont une pathologie autant qu’un art du comportement humain. Ils se plaisent, aucun obstacle majeur ne les empêche de se prendre la main, chacun à sa manière est libéré de tout engagement. Derrière la minauderie de Graziella et la galanterie d’Archimède se cachent leurs dernières réticences à se lancer dans une nouvelle aventure. Ils devinrent amants après plusieurs entrechats mondains et fous rires coquins.
Ils dinent chez l’un et dorment chez l’autre. Dans la journée c’est quartier libre. Chacun vaque à ses occupations. Des week-ends en bord de mer, des séjours à la montagne agrémentent leur complicité. L’achat d’un appartement en commun scella leur union. La maturité et la différence d’âge apportent au couple tranquillité et apaisement. La violence s’est éloignée du corps du vieil homme ; dans un même mouvement de sérénité la femme mature exprime plus clairement ses insatisfactions afin de les combler. Tous deux s’entendent et s’écoutent. Ils vivent leurs envies. Graziella est heureuse car elle sait qu’elle existe dans le cœur de l’homme qu’elle aime. Au pays des amoureux tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté (Baudelaire). Cependant, après plusieurs mois, une chose chagrine Archimède. Il s’étonne que Graziella ne lui ait jamais parlé d’avoir un enfant. Il feint d’aborder innocemment ce sujet d’une gravité merveilleuse : entre deux personnes qui s’aiment n’y a-t-il pas l’esquisse d’un enfant à naitre ? La réponse de Graziella le rassure et l’inquiète : elle est bien demandeuse…mais elle souhaite avoir deux enfants avec lui ! Le poids des ans et des préjugés pèsent sur leur conversation.
Les copains d’Archimède lui disent qu’il est fou, qu’il ne se rend pas compte des corvées d’un futur jeune papa. Il n’aura plus un moment à lui ! Il rétorque qu’il sera à la fois père à mi-temps, car lui et Graziella se feront beaucoup aider, et grand-père à plein temps pour profiter à fond de ce bonheur tardif. Il le pense mais ne le dit pas à ses potes : il espère demeurer un amant attentionné et présent.
Le Club des Poulettes supplie Graziella de bien réfléchir, de ne pas mettre sa santé en danger pour un caprice qui n’est plus de son âge ; elles en rajoutent une couche en lui promettant un rapide veuvage. Elle les regarde du coin de l’œil : ne vaut-il pas mieux être veuve d’un homme qui vous laisse de quoi élever deux enfants que seule et divorcée d’un salaud ?
Conscients du bonheur qu’ils ont eu de se rencontrer, de la volatilité des affaires amoureuses – et de leur inconséquence parfois –, certains que leur complicité ne trouvera son salut qu’au sein d’une vie de famille, ils décident de faire fi à toutes les idées préconçues et de suivre l’élan de leurs cœurs et de leurs enthousiasmes.
La pire chose qui aurait pu leur arriver aurait été de passer à côté l’un de l’autre sans reconnaître l’amour de leur vie. Le grand gâchis – ils sont heureux d’en convenir ensemble – serait de se complaire dans leurs attirances, de s’enfermer, et de ne pas prendre le risque de se réinventer au-delà de leur petite histoire immédiate. Le souhait exprimé dans leurs beaux sourires est de tenir la gageure de se retrouver en tentant de faire des enfants dans un total dépassement d’eux mêmes. Pour le meilleur et pour le rire !